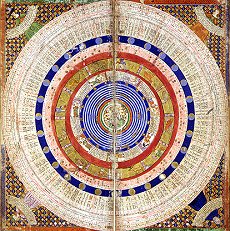- L'histoire du Prêtre-Jean est un exemple
typique du mythe du héros, né de l'imagination humaine à partir d'un
fait réel, mais que les distances ou les événements rendent invérifiable.
On voit se former un personnage de légende, paraissant toutefois appartenir
à la réalité quand il se trouve étayé par quelques brins de vérité.
Il est utilisé ensuite par des intérêts liés à la religion, à la politique,
à la guerre ou au commerce, sans perdre pour cela son influence mystique
sur les esprits crédules.
- Apparu dans l'Europe du Moyen Age, à l'époque
des croisades, le mythe place dans un Orient mystérieux un souverain
chrétien riche et puissant, capable de prendre l'islam à revers, et
par conséquent de sauver la Jérusalem chrétienne.
- Le Prêtre-Jean avait eu un prédécesseur,
le roi David, nom que se transmettaient les souverains de la dynastie
chrétienne des Bagratides qui régnèrent en Géorgie et en Arménie entre
886 et 1045, et qui prétendaient descendre du roi biblique. On le
trouve représenté sur les mappemondes médiévales comme le porteur
des clefs des portes du Caucase qui arrêtent les démons Gog et Magog.
- En 1046, les Seldjoukides (des Turcs islamisés
arrivés au Moyen-Orient) conquièrent l'Arménie, puis, en 1054, la
Géorgie. Peu à peu, le souvenir de roi David s'efface, il est « remplacé
» par un mystérieux Prêtre-Jean. Le point de naissance du mythe
est peut-être l'événement relaté dans la chronique de l'évêque
Otton de Freising, oncle de l'empereur d'Allemagne, qui écrit qu'en
1145 un représentant des Eglises orientales, l'évêque arménien de
Jabala (l'antique Byblos), est venu à Rome annoncer que la prise
récente d'Edesse par les musulmans risque de provoquer la destruction
des communautés chrétiennes d'Orient. Mais,
ajoute-t-il, un souverain chrétien, à la fois roi et prêtre, nommé
Jean, dont le royaume se trouve dans la lointaine Asie, au-delà même
de la Perse, s'est mis en route vers l'Occident à la tête d'une armée
formidable qui a commencé par vaincre des armées de musulmans, mais
qui a été contraint de retourner momentanément dans son pays à cause
d'une épidémie qui a ravagé ses troupes. Cette déclaration a sans
doute pour but d'inciter les croisés, attaqués par les Turcs à tenir
bon car le Prêtre-Jean va revenir avec sa puissante armée pour sauver
le royaume chrétien de Jérusalem.
- La nouvelle a cependant une origine
bien réelle, mais son interprétation est détournée. Il s'agit
en effet de l'écho lointain de la victoire de la tribu mongole
des Kara-Khitaï en 1141 sur une armée de Seldjoukides stationnée
en Asie Centrale. A ceci près que les Kara-Khitaï, voisins de
la Chine, sont en réalité des bouddhistes. Mais la présence
de chrétiens nestoriens dans les populations d'Asie Centrale
contribue probablement à la légende. Les nestoriens (voir Historia
Thématique n° 82 ) sont des chrétiens condamnés comme hérétiques
par le concile d'Ephèse en 431, pour leur croyance en la nature
divine et humaine distinctes dans le Christ. Rejetés par l'Eglise
catholique, ils se sont installés en Asie où ils ont acquis
des positions importantes : il y aura des nestoriens même dans
la famille de Gengis Khan. Leur dévotion en Jésus et le port
de la Croix sur leurs vêtements les feront prendre par les premiers
voyageurs européens et par les chroniqueurs pour des sujets
du Prêtre-Jean en personne.
|
|
- Curieusement,
l'annonce de l'évêque arménien provoque pendant plusieurs années
l'apparition de lettres émanant prétendument du Prêtre-Jean, adressées
au pape Alexandre III, à Frédéric Ier Barberousse, empereur germanique,
à Louis VII roi de France et à Alphonse Enriquez, roi du Portugal.
Il y est écrit que le Prêtre-Jean étend sa domination sur les trois
Indes et sur plusieurs autres pays, que soixante-dix rois sont ses
vassaux, que parmi les peuples soumis il y a, entre autres, les dix
tribus perdues d'Israël qu'Alexandre le Grand a enfermées derrière
la muraille de Gog et Magog. Quand ce Prêtre-Jean part à la guerre,
il fait brandir dix croix d'or ornées de pierres précieuses, derrière
chacune d'elle marchent dix mille cavaliers et cent mille hommes à
pied. Dans la lettre à Manuel Comnène, empereur Byzance (1143-1180),
le Prêtre-Jean ajoute qu'il est le propriétaire de la rivière Ydonis
qui vient du paradis terrestre chargée d'émeraudes, de saphirs, de
rubis et de... poivre ! Il prétend avoir une fontaine qui donne l'âge
de 32 ans à tout homme qui s'y baigne ; lui-même déclare qu'il a 562
ans parce qu'il s'y est baigné six fois. Il dit aussi qu'un grand
roi d'Israël est son vassal et qu'il reçoit de lui un tribut annuel
de deux cents chevaux chargés d'or et de pierres précieuses. Ces fables
sont tout à fait prises au sérieux par les hommes du Moyen Age, enclins
à croire au merveilleux.
- Plus la pression de l'islam se fait menaçante
contre la Terre Sainte, plus la croyance en l'existence du Prêtre-Jean
se répand en Europe. L'évêque d'Acre écrit au pape Honoré III, en
1219, que le Prêtre-Jean, avec ses puissantes armées, est l'envoyé
de Dieu qui va venir exterminer les païens et les musulmans. Quoi
qu'il en soit, personne ne sait où se trouve son royaume, mais on
se remet à penser à l'Extrême-Orient. On envoie en Asie des moines
chargés de le trouver. Le frère franciscain Jean du Plan Carpin, de
retour de Mongolie en 1247, propose Muhammad sultan du Kharezm comme
candidat possible. Mais le moine et chroniqueur Guillaume de Rubrouck,
en 1254, lui préfère un chef des Naïmans, mongols en partie manichéens,
tout en reconnaissant que leur nombre et leur puissance sont très
inférieurs à ce qu'on pouvait attendre du Prêtre-Jean. Ce sont là
quelques exemples de tentatives pour identifier le sauveur espéré.
Pour Marco Polo, le Prêtre-Jean est le khan des Ongüt, tribu turque
manichéenne installée près de la boucle du fleuve Jaune, opinion partagée
par le frère Jean de Monte-Corvino, envoyé par le pape en 1305 en
Chine, et qui rapporte qu'il a rencontré près de la Muraille un roi
chrétien nommé Georges, qui se prétend descendant du Prêtre-Jean «
des Indes ».
- Pourtant, l'opinion la plus générale
est que le royaume du Prêtre-Jean se situe quelque part en Asie
Centrale ou en Chine, bien que l'on persiste à l'appeler Prêtre-Jean
des Indes. A partir de l'arrivée de Gengis Khan, en 1206, et
des conquêtes mongoles qui s'ensuivent, les récits des voyageurs
sont unanimes à rabaisser le Prêtre-Jean au rôle de simple vassal
du khan. Dans les lettres et les chroniques, on commence à utiliser
le nom de Tatars pour désigner aussi bien les Mongols que les
Turcs nomades. Parmi les Tatars se trouvent des chrétiens, ce
qui explique qu'on persiste à localiser le Prêtre-Jean dans
une des régions de l'Est asiatique. Une des conséquences de
la domination mongole est paradoxalement un extraordinaire mélange
de populations, avec un développement des voyages entre l'Occident
et l'Orient. Moines et marchands chrétiens rapportent, à leur
retour d'Asie centrale et de Chine, la nouvelle désolante de
l'inexistence probable du « vrai » Prêtre-Jean dans ces régions.
|
|
- Ne
l'ayant pas trouvé en Asie, la chrétienté européenne transporte le
mythe en Inde. Il existait déjà des communautés anciennes de chrétiens
indiens, appelés chrétiens de saint Thomas, du nom du premier évangélisateur
de l'Inde. Les brahmanes, réputés chastes et vertueux, sont un moment
pris pour des chrétiens retirés du monde. On trouve aussi une allusion
à un souverain chrétien de l'Inde du Nord dans le récit que Clavijo
fait de son ambassade auprès de Tamerlan en 1406, mais il se contente
de le désigner par une initiale : « On l'appelle N.» (Négus ?) D'ailleurs,
au Moyen Age, ce qu'on appelle Inde prête à confusion, notamment chez
les cartographes qui en poussent les limites jusqu'en Afrique orientale.
- Depuis longtemps, les Occidentaux
connaissent l'existence d'un empire éthiopien, situé quelque
part vers la Nubie ou l'Egypte, par des moines abyssins arrivés
en pèlerinage à Jérusalem et par la remise d'une lettre du négus
au pape. Un moine dominicain, frère Jourdain de Severac, nommé
évêque sur la côte du Malabar par le pape Jean XXII, rédige
à son retour une relation assez fantaisiste de son voyage où
il parle de l'Inde troisième, qu'il situe vaguement du côté
de l'Afrique orientale, près du lac Zanzibar. Il reste pourtant
des gens qui persistent à placer le Prêtre-Jean en Asie de l'Est
et d'autres qui le croient en Inde, en dépit de n'avoir pas
pu l'y découvrir dans toute sa gloire.
|
|
- Au XIVe siècle, l'idée que l'Ethiopie
pourrait être le royaume du Prêtre-Jean commence à gagner du terrain,
surtout après qu'une ambassade envoyée par le negusa nagast (négus
d'Ethiopie, en éthiopien) arrive à la cour papale d'Avignon en 1310.
La venue en Europe d'autres voyageurs éthiopiens, ainsi que la diffusion
d'informations provenant de chrétiens ayant séjourné au Moyen-Orient
et en Arabie, confortent l'opinion qu'il existe bien quelque part
vers la pointe nord-est de l'Afrique un royaume chrétien nommé Ethiopie
(nom peu familier aux Européens qui le rapprochent du grec aithiopios
« au visage brûlé, noir ») et dont le souverain, à la fois prêtre
et roi, est en guerre contre les musulmans. Plusieurs chroniqueurs
arabes lui prêtent même le pouvoir redoutable de détourner le cours
du Nil - en réalité, c'est le Nil bleu, une des grandes branches du
Nil qui coule en Abyssinie - pour assécher et ruiner le Soudan et
l'Egypte, et la menace de cette arme écologique renforce le désir
des chrétiens de s'allier à lui contre l'islam. Les informations sur
l'emplacement exact de ce pays et sur son roi, que l'on continue malgré
tout à appeler le Prêtre-Jean, restent assez floues. La découverte
de son royaume, l'Ethiopie, et de son souverain, le négus, sont l'oeuvre
du Portugal, alors le premier pays européen à lancer ses navires sur
les mers du Sud. On trouve trace du passage d'un ambassadeur éthiopien
appelé Georges à Lisbonne en 1452. Il est peut-être déjà question
d'un projet d'alliance, car le roi du Portugal, Alphonse V, décide
en 1454 que l'ordre du Christ, dont le prince Henri le Navigateur
est le grand maître, ajoutera à sa juridiction la Guinée, la Nubie
et l'Ethiopie.
- Cependant, ce qui va amener le mythe du
Prêtre-Jean sur l'impitoyable terrain de la réalité est sans doute
l'extraordinaire information recueillie en 1486 par les navigateurs
portugais auprès des populations du Bénin alors qu'ils commencent
l'exploration des côtes africaines en vue de la découverte de l'Inde
: « A vingt lunes de marche, leur disent les notables du Bénin, vers
le nord, au sud de l'Egypte, règne le grand roi Ogané, que nous vénérons
et à qui nous envoyons des ambassadeurs. Nous ne le voyons jamais
car il nous reçoit dissimulé derrière un grand voile d'où sort seulement
son pied quand il nous donne congé. » Depuis des temps anciens, les
nobles du Bénin doivent recevoir son approbation pour élever au trône
celui d'entre eux qui doit succéder au roi défunt. Il donne son accord
en lui envoyant un casque et une croix en cuivre brillant. Le nouveau
roi du Bénin se doit de porter cette croix à son cou s'il veut être
reconnu officiellement. Au vu du rapport de ses navigateurs, le roi
Jean II du Portugal envoie deux moines en éclaireurs vers le pays
du roi Ogané, mais ils ne peuvent même pas dépasser Jérusalem car
ils ne parlent pas l'arabe.
- Le roi du Portugal et ses conseillers pensent
que le roi Ogané - on ne connaît aucun roi d'Ethiopie de ce nom !
- est en réalité le Prêtre-Jean et que son royaume doit se trouver
dans la partie arabique de l'Inde mineure que l'on appelle Ethiopie.
Il envoie cette fois-ci deux hommes expérimentés, Pedro da Covilhã
et Afonso de Paiva, à qui il remet une lettre pour le Prêtre-Jean,
un planisphère pour y marquer l'emplacement exact de son royaume et
une somme d'argent.
- Les émissaires partent le 7 mars 1487,
habillés à l'arabe, et gagnent Le Caire. Là, ils se séparent. Pedro
da Covilhã doit se rendre d'abord en Inde pour découvrir le port d'embarquement
des épices destinées aux pays méditerranéens, et Afonso de Paiva doit
aller jusqu'en Ethiopie pour y rencontrer le Prêtre-Jean, étant entendu
qu'ils se retrouveront au Caire après leur mission. Afonso de Paiva
disparaît en cours de route, sans laisser de trace. Pedro da Covilhã,
de retour de son périple en Inde, est rejoint au Caire par un marchand
juif porteur d'une lettre du roi Jean II qui ordonne de poursuivre
coûte que coûte la recherche du Prêtre-Jean. Parfaitement intégré
au milieu musulman, Pedro da Covilhã réussit à traverser l'Arabie
et à débarquer à Zeila, l'ancien port éthiopien. De là, il s'enfonce
à l'intérieur des terres et gagne les hauts plateaux pour y trouver
enfin, près de la capitale royale Gondar, le campement impérial où
il est accueilli chaleureusement, en l'an 1494, par le négus qui se
nomme « Alexandre, Lion de Juda, Roi des Rois ». Rien à voir avec
le Prêtre-Jean ! Mais les Portugais s'obstinent à appeler les empereurs
d'Ethiopie Prêtre-Jean, pour le prestige sans doute, et peut-être
parce que les sujets de l'empereur s'adressent à lui en disant zan
hoy « monseigneur », ce qui semble avoir une analogie phonétique avec
Jean.
- L'empereur d'Ethiopie est certes
chrétien, de l'antique rite copte, proche de la religion hébraïque,
héritier d'un royaume qui a dominé jadis tous les pays face
à l'Arabie, mais que l'arrivée de l'islam et son extension ont
refoulé des rives de la mer Rouge et réduit aux régions des
plateaux et des hautes montagnes où passe le Nil bleu. Cependant,
les empereurs d'Ethiopie continuent à résister aux attaques
acharnées des pays musulmans qui les encerclent. Il existe même
en Ethiopie une communauté de juifs retirée dans des lieux inaccessibles.
Pedro da Covilhã, le premier ambassadeur européen qui rencontre
le négus, a un destin pittoresque. Il se prépare à regagner
le Portugal lorsque le négus Alexandre meurt et que son successeur,
le négus Naod, lui enjoint de rester : la coutume veut qu'on
ne laisse pas repartir un étranger talentueux que l'on aime.
On lui fournit une résidence et une épouse éthiopienne (Covilhã
est déjà marié au Portugal) dont il aura plusieurs enfants.
Traité comme un noble, il est reçu à la cour où il rencontre
Nicola Bianca, un peintre italien, qui peint des fresques dans
les églises éthiopiennes.
|
|
- Plus de vingt ans passent jusqu'à l'arrivée
en 1520 d'une nouvelle ambassade portugaise envoyée par le roi Manuel
II. Quand celle-ci repart, le négus Lebna Dengel (que les Portugais
appellent David) autorise Covilhã à la suivre. Mais celui-ci, qui
pourtant a montré une grande joie à revoir ses compatriotes, refuse
et choisit de rester en Ethiopie où il termine ses jours entouré des
siens. Dans cette ambassade se trouve le père Francisco Alvares qui
va écrire une relation détaillée des gens, des coutumes, des rites
et des terres de l'Ethiopie de son temps, publiée en 1540 à Lisbonne,
Verdadeira Informação das Terras do Preste Joao das Indias . C'est
donc au début du XVIe siècle que le personnage mythique du Prêtre-Jean
est remplacé par un souverain chrétien bien réel, allié des Portugais.
Ceux-ci opèrent alors en mer Rouge contre les musulmans, renforcés
par l'arrivée des Turcs et qui détiennent par surcroît la voie du
passage des marchandises venues de l'Inde. Ce sont donc des concurrents
redoutables.
- Pendant les rares périodes de paix avec
ses voisins, le négus se montre magnifiquement vêtu, entouré d'une
cour bariolée, va prier dans les églises creusées dans le rocher,
sous le patronage de l' abuma (le patriarche nommé par l'Eglise jacobite
d'Alexandrie). Le barnagais (commandant des terres de la mer) guide
les envoyés portugais jusqu'à lui. Son armée est très combative, mais
insuffisante en nombre et équipée seulement d'armes blanches, alors
que les musulmans possèdent des arquebuses et des canons fournis par
les Turcs. Ces derniers arrivent de plus en plus en mer Rouge et les
navires portugais tentent avec difficulté de s'y opposer. Le Prêtre-Jean
est leur unique allié dans ces régions, mais il vient de subir une
terrible défaite et doit se réfugier avec ses derniers fidèles dans
les montagnes. Il appelle les Portugais à son secours. Ceux-ci réussissent
en 1541 à débarquer une troupe de 400 hommes avec des canons commandée
par Christophe de Gama, neveu du grand Vasco, et à battre l'armée
des musulmans. Ils sont eux-mêmes vaincus par une puissante contre-attaque
et perdent 200 hommes, dont leur commandant. Les survivants portugais
rassemblent autour d'eux des paysans éthiopiens, mettent à leur tête
le jeune et vaillant négus Galawdewos (Claudius), et remportent une
victoire totale sur les musulmans le 22 février 1543. Ainsi les Européens,
qui ont attendu pendant des siècles d'être sauvés en Orient par le
Prêtre-Jean, le sauvent au prix de leur sang. La quête mythique est
bien achevée.
- Installée par Jean III en 1536, l'Inquisition
portugaise envoie des jésuites enquêter sur les pratiques religieuses
du Prêtre-Jean. Lui-même et ses sujets sont décrétés hérétiques. Même
si l'Ethiopie a grand besoin de canons et de munitions, le négus en
1557 refuse devant une délégation de jésuites venus de Lisbonne de
convertir l'Ethiopie au catholicisme. Et quand son successeur accepte
de le faire l'année suivante, il est désavoué par son clergé et par
son peuple qui veulent continuer à pratiquer l'ancienne religion de
leurs aïeux. La réprobation est générale : les derniers jésuites sont
expulsés de l'Ethiopie en 1634, mettant définitivement fin à cent
quarante années de relations amicales entre l'empire éthiopien et
le Portugal. Le mythe du Prêtre-Jean n'a pas pu résister à la réalité.
- Comprendre
- Tatars (ou Tartares) Tribus appartenant à la configuration des tribus
mongoles, ennemies, puis soumises à Gengis Khan. Indes Au Moyen Age,
on compte plusieurs
- Indes : l'Inde mineure, au-dessus de l'Indus ; la Grande Inde, entre
l'Indus et le Gange ; la Troisième Inde, au-delà du Gange. Pour certains
auteurs, l'appellation Inde englobe aussi une partie indéfinie de
l'Afrique orientale
Qui
se cache derrière le Prêtre-Jean ? [Page originale de "Historia"]
- Autres
pages www sur Lucien Kehren
|